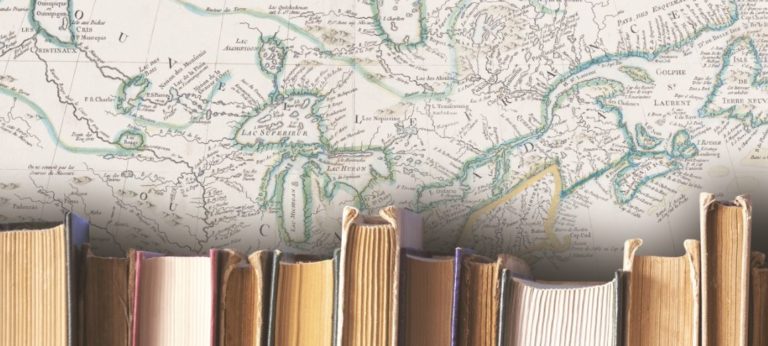Notre entretien
avec l’auteur
Depuis quelques années, tant le concept d’histoire que celui de nation sont la cible de profondes remises en question, voire d’attaques frontales. Ce livre répond-il à un sentiment d’urgence chez vous qui avez souvent affirmé votre foi en ces idées ?
En effet, la science historique et la nation – les deux composantes principales de l’histoire nationale – sont la cible de dures critiques. Sur ces deux sujets, on soumet l’histoire à un procès qui n’est pas neuf mais qui se fait ces temps-ci plus sévère. On conteste son statut de science parce qu’elle est changeante et qu’elle n’arrive pas à établir des consensus sur des questions fondamentales. On s’en méfie aussi à cause de son alliance avec la nation accusée, elle, de racisme, de discrimination et autres dérives.
Ce qui change périodiquement dans la science historique, ce sont les éclairages qu’elle projette sur le passé et les nouvelles significations qu’elle en tire pour le bénéfice des contemporains. C’est inévitable et ce n’est pas un vice. L’histoire a pour fonction principale d’apporter des matériaux à la réflexion sur les inquiétudes et les problèmes de l’heure. Par exemple, depuis quelques années au Québec, elle accorde beaucoup d’attention à la condition féminine, aux questions identitaires, à l’inclusion et au racisme, spécialement en rapport avec les Autochtones et les Noirs.
Auparavant, elle mettait surtout l’accent sur les classes sociales, les inégalités et les rapports de pouvoir. Elle était très sollicitée également par les questions de développement inégal et par le colonialisme. Du moment que les questions et les réponses changent sans amener l’historien ou l’historienne à trafiquer les données du passé, où est le mal? Une histoire qui serait entièrement coupée des inquiétudes du présent serait peu utile.
Pour diverses raisons, les consensus sur les sujets fondamentaux sont très difficiles et souvent impossibles à atteindre. D’abord, l’histoire a pour objet le social, une matière extraordinairement complexe. Le devenir de l’humain en société résulte de la confluence d’une multiplicité de facteurs à conjuguer, très souvent imprévisibles. Or, le devenir des collectivités humaines se dérobe à la quête de régularités prenant la forme de lois comme il arrive dans les sciences naturelles. Son devenir même ne se prête que partiellement à la quantification et encore moins à l’analyse stricte de causalités, sauf quelques exceptions (en économie et en démographie, par exemple).
Retenons que toute science construit sa démarche en fonction de l’objet dont elle doit rendre compte. Chacune doit s’ajuster à ses particularités. Dans tous les cas, des règles de méthode s’imposent qui garantissent la rigueur.
Pour ce qui est des attaques contre la nation et de l’idée assez répandue de la sacrifier au profit d’une histoire globale (ou mondialisée), il faut en prendre et en laisser. Une histoire nationale qui ne serait pas ouverte à l’international serait évidemment très appauvrie. Par contre, la nation comme cadre d’action et de réflexion va probablement se maintenir encore longtemps. L’« ordre » mondial, dans son état chaotique actuel, n’inspire guère confiance. On ne voit pas l’heure où on pourrait transposer à un régime planétaire les fonctions que remplit présentement l’État-nation – je pense notamment à l’exercice de la démocratie, à l’institution d’une solidarité collective, à l’administration de la justice, aux administrations de proximité. Enfin, dans le passé, la nation et le nationalisme ont certes été coupables de dérives souvent meurtrières. Mais on oublie le cas de nombreuses nations qui s’en sont gardées. On en conclura que ce n’est pas la nation en elle-même qui est viciée mais l’usage qu’en font trop souvent les acteurs qui en assurent la gestion.
La société québécoise entretient un lien complexe et problématique avec le passé, donc avec son histoire. Y a-t-il une spécificité québécoise dans la façon dont la crise actuelle, touchant la recevabilité des grands récits partagés, est vécue ?
S’agissant de l’historiographie québécoise, j’hésite à parler de crise. J’ai le sentiment que les commentateurs et commentatrices font un usage abusif de cette expression. On peut parler de crise quand on n’y voit vraiment plus clair et que les questions qui se posent remettent en question le travail même des spécialistes ou la valeur même de l’histoire comme discipline à part entière. Ce n’est pas le cas au Québec. Dans toute société, il existe des dissensions profondes sur des enjeux vitaux qu’on n’arrive pas à surmonter. Le Québec ne fait pas exception sur ce point. Les désaccords profonds entre scientifiques sont souvent à la fois le reflet et le produit de fractures dans l’écologie même du social. Il serait illusoire de penser que la science historique aurait le pouvoir de les refermer.
L’histoire a pour fonction principale d’apporter des matériaux à la réflexion sur les inquiétudes et les problèmes de l’heure.
Extrait de l’entretien
Inversement, depuis la Conquête à tout le moins, le Québec a été le lieu de déploiement de récits historiques divergents et concurrents. Cela pourrait-il se traduire par l’élaboration de solutions originales visant à résoudre cette crise ?
Je reprendrais ici ce que j’ai dit à propos du diagnostic de crise et des controverses en histoire. Après plus de deux siècles de débats, le désaccord sur la Conquête subsiste, avec sa contrepartie en politique. Il en sera vraisemblablement ainsi tant que d’autres enjeux collectifs de plus grande envergure ne viendront pas déplacer cette vieille antinomie vers les marges de l’imaginaire – comme il est arrivé (à moindre échelle, il est vrai) avec l’émigration des Canadiens français aux États-Unis (l’ « hémorragie » du Canada français), l’exode rural ou la déchristianisation associée à la Révolution tranquille. Les vifs débats suscités par chacun de ces épisodes ont fini par s’éteindre parce que la roue de l’histoire a tourné, donnant ainsi naissance à d’autres enjeux plus pressants, à d’autres débats et… à d’autres dissensions.