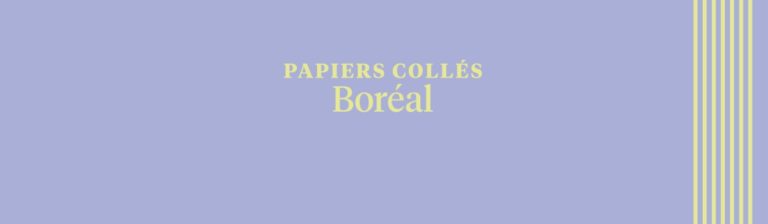Notre entretien
avec l’auteur
Que signifie pour vous le terme déambulations, qui est le fil conducteur des textes que vous réunissez sous ce titre ?
Pour tout vous dire, même si j’ai des amis qui me sont chers, je suis et j’ai toujours été d’une nature solitaire, et la déambulation – physique, mentale et mémorielle – est le sport préféré des esseulés volontaires. Un sport et un plaisir entremêlés, une liberté grande. Et ces déambulations, dans le sens où je l’entends, dans l’esprit où je les ai menées et écrites dans cet essai, sont évidemment livresques, littéraires ; ayant passé l’âge du jogging suant, je me promène assis, au sec, au chaud, un bouquin sous la lampe, et j’excursionne à ma guise dans les livres que je choisis dans ma bibliothèque où il n’y a aucun risque de trébucher ; il n’y a pas d’ivraie, pas de ray-grass dans mes pelouses littéraires, mes rayonnages sont exempts de faisans et de guet-apens ; des décennies de fréquentation avec les littératures du monde entier m’ont formé un goût assez sûr, je déambule dans des œuvres sécurisées par le talent et le génie des écrivains que j’aime. Je dois dire que je relis plus encore que je ne lis, car revenir se promener dans un coin de pays connu nous le fait connaître encore plus, encore mieux. Trois fois ai-je traversé le continent Proust, combien de fois ai-je entrepris le voyage célinien, je ne sais plus…
Solitaire, vous disais-je. Comme le « vieux parc » de Verlaine. Et vous réaliserez que, dans Déambulations, parmi les auteurs visités, il y a nombre de célibataires : Kafka le casseur de fiançailles, Julien Gracq, Robert Walser, Beckett qui, quoique marié, était demeuré ancré dans le camp du célibat. Un écrivain est toujours seul et toujours il avance, on n’a qu’à le suivre de loin, à notre rythme.
« Avant d’écrire, il faut marcher », écrivez-vous au début de votre essai sur Jean Echenoz. Pourquoi l’écriture serait-elle liée à la marche ?
Ah ! ça, c’est Echenoz. Là, je me suis tout simplement amusé à le suivre en me servant d’un texte qu’il avait gardé au tiroir et dont il a accepté la publication dans le « Cahier de l’Herne » qu’on lui consacra en 2022. Un journal de bord farfelu, tenu alors qu’il allait se mettre à écrire Vie de Gérard Fulmard. Tout un programme. Comment un romancier (il en est un de première) arrive-t-il a trouver le chemin d’un éventuel roman que parcourront ses lecteurs? En empruntant une rue. Il lui fallait une rue, une rue inconnue, et il la chercha, l’arpenta, la renifla, en espérant arriver à y saisir une inspiration. Peine perdue, mais le roman est venu à lui de lui seul.
Oui, l’écriture est liée à la marche, en ce sens que toute marche solitaire, lorsqu’on fait métier d’écrire, est équivalente à la démarche d’un savant qui entre dans un laboratoire. Observations, tests, essais, hasards, vérifications, avancées ; Zola, en la matière, était un grand chercheur et un maître-espion, Simenon aussi ; comme Modiano et Jean Rolin aujourd’hui, ils ont besoin des rues perdues pour rejoindre et atteindre leurs destinations si tant est qu’ils en aient. Un écrivain est un agent de circulation et souvent un détective, il cherche, il piste, s’il est taximan il se met en maraude, il attend le client, il l’embarque et, d’autorité autant que d’instinct, il l’emmène où il veut en évitant les indications, les flèches et les passages cloutés.
Un sport et un plaisir entremêlés, une liberté grande.
Extrait de l’entretien
La déambulation suppose une certaine lenteur qui contraste avec les accélérations en tous genres qui caractérisent le monde d’aujourd’hui. Est-ce pour vous une façon de résister au rythme effréné qui nous est imposé ?
Absolument. Totalement. Mais je n’ai pas à dépenser d’effort pour « résister au rythme effréné qui nous est imposé », comme vous dites. Je suis depuis toujours un résistant spontané au bruit – « le quartier général du bruit », écrivait Kafka – et je suis donc naturellement insensible à tout rythme collectif, tout grégarisme, je ne me suis jamais lié à un réseau dit social, je n’ai pas d’amis en ligne jamais vus, je ne possède aucun de ces bidules dits intelligents, je ne suis abonné à rien (Jean-Pierre Ronfard au théâtre détestait le système des abonnements qu’il liait au devoir plus qu’au plaisir), je vais au cinéma en salle et au concert en joie, j’éteins la télé, je lis les grandes pages du Monde diplo à chaque mois, j’aime recevoir des cartes postales d’amis qui voyagent, je donne des rendez-vous dans des cafés que je sais déserts et je ne rate jamais la séance de cinéma muet les vendredis à la Cinémathèque québécoise.
Je me souviens d’un printemps d’il y a presque trente ans où j’avais décidé de circuler un temps dans Montréal en n’empruntant que ses ruelles, ce qui me donnait paradoxalement un sentiment de grand espace, dégagé, empli de silence, celui d’entrer dans le secret des lieux, d’être mis dans la confidence des heures creuses. Je déambulais à l’écart, dans les marges.
Les écrivains que vous citez, qui sont vos compagnons de route pour ainsi dire, sont tantôt des écrivains urbains, comme Victor Hugo ou Georges Perec, tantôt des écrivains de la campagne, comme Robert Walser ou Peter Handke. Est-ce qu’on déambule de la même façon en ville et à la campagne ?
En ville, on est un marcheur, un piéton ; la littérature en compte tant depuis Apollinaire, Fargue et, ici, un Patrick Straram, une Régine Robin. À la campagne, on est un randonneur, un vagabond, voire un montagnard, on erre, on file, on grimpe, on bivouaque ; je pense à Dante en exil qui ne séjournait jamais longtemps nulle part, à Montaigne allant à cheval, et à Knut Hamsun bien sûr, à Robert Walser qui mourût au cours d’une promenade d’hiver, à Handke qui ne tient jamais en place, à Hermann Lenz et son Der Wanderer, à la trekkeuse Simone de Beauvoir dans ses échappées si loin de sa « germanopratrie »…
Mais, de toutes façons, rats des champs ou rats des villes, les écrivains déambulateurs à l’intérieur des œuvres desquels j’ai entrepris de déambuler assis, au chaud, sous la lampe, n’ont pas franchement de différences marquantes entre eux à partir du moment où, chacun à sa manière, ils sont animés (éclairés) par la même flamme, celle de la liberté de circuler, ce grand héritage homérique toujours à reconquérir et toujours à sauvegarder.
Livre publié dans la collection « Papiers collés ».