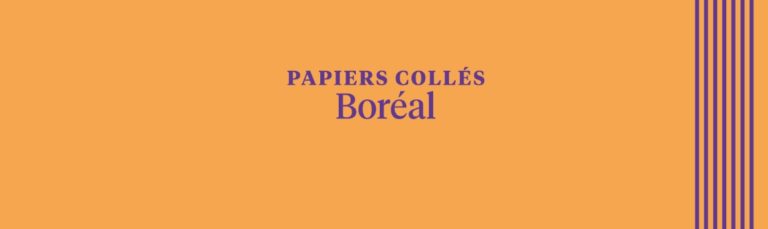Notre entretien
avec l’auteur
Pourquoi avoir choisi de situer l’art du roman tel que vous le décrivez dans votre essai sous le signe de Cervantès ?
C’est le Foucault de Les Mots et les Choses qui m’a convaincu que Don Quichotte était le premier grand roman moderne, le premier roman à exprimer, sur un mode ludique et parodique, l’ambivalence du réel et la conscience de n’être qu’une représentation. Et j’ai assez fréquenté le roman latino-américain pour voir en Cervantès, plus que le père des littératures hispanophones, un vieux maître du genre romanesque lui-même. Le Quichotte est une figure littéraire qu’un romancier québécois peut très bien s’approprier, comme l’ont fait avant moi Victor-Lévy Beaulieu, dont une partie de l’œuvre est écrite sous le saint patronage de cet hidalgo fou de livres (Don Quichotte de la Démanche), et même Jacques Ferron : le Parti rhinocéros, en même temps qu’un génial pied de nez politique, était une créature purement quichottienne. C’est la folie de Quichotte contre l’ordre du monde, et maintenant que la rébellion est devenue une simple posture récupérée d’avance par l’ordre établi, le chevalier fait figure de gardien du temple. Prosaïsme, ironie, imagination : les trois qualités essentielles que j’attribue à la composition romanesque, le gros roman de Cervantès les a portées bien haut, comme l’a fait aussi Rabelais avant lui. Les romans qui m’intéressent viennent de là.
Vous ouvrez votre essai sur la situation du roman au Québec, en citant notamment Victor-Lévy Beaulieu. Vous sentez-vous proche de ce dernier et, de façon générale, comment vous situez-vous par rapport au roman québécois contemporain ?
Lorsque je suis arrivé en littérature, on m’a parfois comparé, un peu précocement peut-être, à ces deux géants qu’étaient Ferron et VLB. Quand, dans le chapitre des Héritiers de Don Quichotte intitulé « Le grand homme de province », je reviens sur les œuvres de ces auteurs, c’est une manière pour moi, trente-cinq ans plus tard, de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de marquer mon propre territoire à l’intérieur de la littérature québécoise. Dans ce chapitre, à travers les œuvres de VLB et de Ferron, j’ai essayé d’analyser le plus objectivement possible les conditions de la création littéraire au Québec, en posant, entre autres, la question suivante : comment être le grand écrivain national d’une nation qui se refuse obstinément à exister en tant que telle ? Je m’y montre plutôt critique de leurs œuvres prolifiques, de leur graphomanie surtout, eux qui déboulaient avec un nouveau livre aux six mois. Se répandre et publier plutôt que de concentrer et élaguer. C’est pourquoi, même si le jugement est sans doute un peu sévère, j’y avance que le cycle La Vraie Saga des Beauchemin de Beaulieu aurait pu s’intituler La Grande Dispersion, et que Le Ciel de Québec de Ferron est tout sauf le Cent ans de solitude de l’Amérique française. En même temps, comme ces deux-là, j’ai hérité d’une conception qui fait du corpus québécois une littérature nationale. Chaque fois que le cosmopolitisme à la mode et la dénationalisation tranquille de notre monde littéraire arrivent à me faire douter, je n’ai qu’à penser à Gaston Miron et à revoir son sourire de prison sur la photo judiciaire de 1970 pour me fortifier. Voilà donc exactement où je me situe comme romancier québécois : dans le prolongement d’une certaine idée menacée de disparaître.
Prosaïsme, ironie, imagination : les trois qualités essentielles que j’attribue à la composition romanesque, le gros roman de Cervantès les a portées bien haut, comme l’a fait aussi Rabelais avant lui.
Extrait de l’entretien
Tout en vous réclamant de l’héritage de Don Quichotte, vous accordez dans votre essai une place privilégiée au roman américain et à ses chefs-d’œuvre. Comment conciliez-vous les deux traditions, l’européenne et l’américaine ?
Me réclamer de l’héritage de Quichotte ne m’identifie nullement à une tradition européenne, parce que le héros de Cervantès s’est depuis longtemps émancipé de sa Mancha natale pour devenir un archétype universel. Le « Chevalier à la triste figure » est très présent en Amérique latine, où j’ai visité, à Guanajuato au Mexique, le Museo Iconográfico del Quijote contenant des centaines de dessins, de sculptures et d’objets variés à l’effigie de sa célèbre silhouette. Au cours des dernières années, la meilleure réincarnation de ce mythe littéraire est venue d’un Américain de la côte Ouest, Chris Bachelder, auteur d’un époustouflant roman centré sur la figure du militant et écrivain socialiste Upton Sinclair. Moi, le territoire imaginaire qui m’intéresse, c’est les Amériques, dont nous faisons partie, et il se trouve qu’il intéresse aussi beaucoup les auteurs outre-Atlantique. Mais je n’ai pas besoin d’un philosophe français qui débite des fadaises sur Thoreau ou d’un mauvais traducteur de Hemingway pour m’approprier la littérature américaine. Dans un chapitre de mon essai portant sur la traduction, je m’amuse à présenter les Québécois comme les traducteurs naturels de l’Amérique vers le français, dans la foulée de leurs ancêtres coureurs de bois et de ces fameux « truchements » qui servaient d’intermédiaires entre les colonies européennes et les nations autochtones. En français, l’Amérique parle la langue du Québec. Et assez souvent, un roman américain traduit à Paris ressemble à une mauvaise blague.
Dans la troisième partie de votre essai, vous comparez plusieurs films aux romans dont ils s’inspirent. En quoi le territoire de la littérature, selon votre propre expression, serait-il plus libre que celui du cinéma ?
Avant, je croyais que le cinéma était seulement l’esclave de la nécessité de montrer. J’ai découvert qu’il est aussi celui de la morale. Ses millions sont comme un fil à la patte qui l’attache (à travers, par exemple, les focus groups) aux attentes du grand public et à un certain conformisme de la pensée majoritaire, l’éloignant d’autant du risque artistique. Quand on voit de quelle manière des livres tels que Midnight Cowboy et 9½ Weeks, teintés d’une profonde ambivalence morale, sont devenus, en passant à l’écran, des récits plus « propres » – plus présentables –, on ne peut que conclure que le cinéma agit comme un filtre qui lave les histoires plus blanc. Il se pourrait bien que l’évolution actuelle du cinéma américain vers l’univers manichéen des super-héros nous montre une pente naturelle du septième art. L’esthétique, au sens le plus cosmétique du terme, est une autre obsession du cinéma. Combien d’héroïnes de roman ordinaires, voire bien en chair, ont été, comme la Maria Chapdelaine de Gilles Carle, incarnées par des beautés à l’écran ? The Virgin Suicides, le roman de Jeffrey Eugenides, offrait très peu de descriptions physiques des personnages, mais on voyait passer un petit bout de rouquine à un moment donné. Sofia Coppola s’en empare et on se retrouve devant toute une galerie de ravissantes blondinettes. Le territoire du roman, lui, « déchire le voile des apparences », comme dit Kundera, pour nous plonger dans les profondeurs humaines où s’ouvrent les zones grises de l’ambiguïté et de la tentation du mal.
Livre publié dans la collection « Papiers collés ».