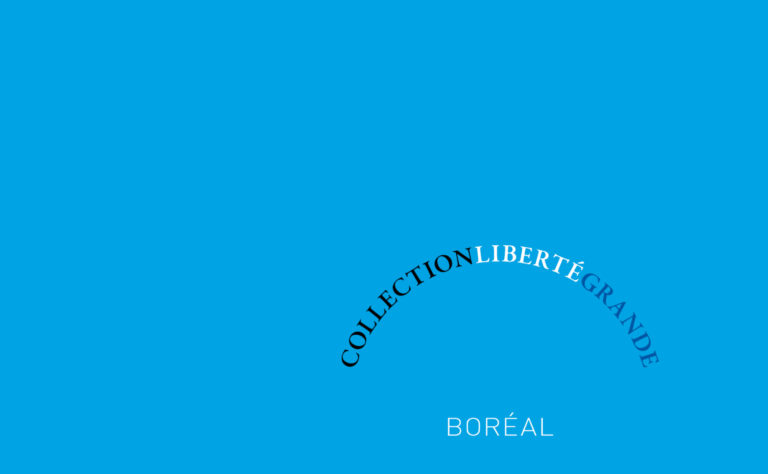Notre entretien
avec Simon Nadeau
Dans votre premier roman, L’Art de rater sa vie, votre héros s’appelait Mèche-au-Vent. Nous le reconnaissons immédiatement sous les traits de La-Mèche-Noire, le protagoniste du Monastère buissonnier. Qu’est-ce qui fait qu’un personnage s’impose à vous au point où vous voulez lui consacrer un deuxième livre ?
Ce changement de nom, léger, j’en conviens, est plus important qu’il n’y paraît… L’Art de rater sa vie racontait l’histoire de Mèche-au-Vent, un jeune montréalais qui se désolidarise des impératifs de la réussite sociale à tout prix. L’enjeu de ce parcours, à la fois rêveur, désinvolte et subversif, était de déjouer, voire de renverser ces valeurs de la réussite sociale, professionnelle et financière, à laquelle – pour réussir ! – on est prêt à sacrifier sa vie et sa liberté. Mèche-au-Vent, lui, choisit de rater sa vie, mais de la rater avec art ! Ce qui change toute la perspective et fait de ce ratage une nouvelle naissance, le début d’une œuvre…
En écrivant L’Art de rater sa vie, j’ai eu l’impression de m’affranchir en même temps que mon personnage. J’étais sans doute encore très habité par lui au moment où j’ai commencé Le Monastère buissonnier. Ainsi est né La-Mèche-Noire, une façon pour moi de marquer la continuité, mais surtout de reprendre là où le précédent livre m’avait conduit, à une liberté de ton et d’allure qui me permettait désormais d’aller plus loin, d’explorer de nouveaux mondes, de nouveaux continents, de nouveaux personnages. Mais Le Monastère buissonnier ne nous raconte pas l’histoire de La-Mèche-Noire. C’est lui qui, au contraire, nous raconte des histoires. Cela change tout ! Il n’est plus le protagoniste, mais le conteur flamboyant dont j’avais besoin pour mon tour du monde. Car Le Monastère buissonnier n’est pas un roman conventionnel. C’est un roman sous forme d’archipel, une succession de récits qui se déroulent tantôt au Japon, tantôt au Cameroun, au Bengale ou en Gaspésie. Certaines de ces histoires, les plus longues, sont de petits romans dans le roman. Évidemment, il y a une idée qui regroupe toutes ces histoires. Mais il y a aussi notre conteur, ce fameux La-Mèche-Noire, qui les relie entre elles, met la table pour la suivante, et s’efface au moment de nous raconter celle de Nembo et de sa petite bande, puis celle de Ramlochan et des enfants qu’il adopte, puis celle d’Audrey et de ses extravagances à ras de falaise… Maintenant que ce livre est terminé, ce n’est plus tellement La-Mèche-Noire qui m’habite que tous les protagonistes sortis de son imagination.
La figure du monastère est centrale dans votre roman. Vous faites aussi référence à des traditions culturelles ancestrales, comme les gurukulas en Inde, qui permettaient autrefois aux jeunes gens de s’instruire dans la maison du maître. Enfin, vous célébrez les livres et toute la culture qui s’appuie sur eux. N’y a-t-il pas un inépuisable fond de nostalgie à la source de votre inspiration ?
Je ne crois pas… Je ne me considère pas comme une personne nostalgique. Je ne promeus jamais non plus un simple retour à ce qui était, à la tradition, aux grandes vérités révélées et admises une fois pour toutes. Ce qui ne m’empêche pas de penser que notre époque pourrait faire mieux – beaucoup mieux ! Mais ce regret est aussi un espoir. L’espérance est chez moi bien plus forte que la mélancolie. C’est elle qui anime tous mes personnages et les pousse à se lier d’amitié. Ensemble, ils se remettent à croire et à rêver, ils imaginent de nouveaux modes de vie, fondent un micromonastère buissonnier au Cameroun, un gurukula urbain en Inde, etc. La ferveur et l’émulation irriguent tous ces compagnonnages que je prends la peine – à une exception près – de situer à notre époque, dans différents milieux. J’aurais pu écrire un roman historique se déroulant au Moyen Âge, par exemple, avec de vrais moines et de vrais monastères. Mais ce n’est pas du tout ce que j’ai fait. Il y a une raison à ça : mes monastères sont « buissonniers », c’est-à-dire que la liberté n’y est jamais sacrifiée au nom de l’idéal. L’idéal, au contraire, doit chaque fois prendre le temps de s’incarner dans des êtres divers et étonnants – mes personnages !
L’aventure du sens recommence avec chacun d’entre nous. C’est pourquoi je ne souhaite pas le retour des « monastères » tels qu’ils ont existé historiquement. Mais chaque fois que deux personnes, cinq, dix ou vingt se réunissent autour d’un idéal commun et d’un élan partagé, il y a ce que j’appelle un « monastère buissonnier », une tentative originale pour renouveler et relancer la culture. Mes personnages ne sont pas du tout nostalgiques. Ils n’ont pas peur cependant de s’inspirer de ce qu’il y a de plus substantiel dans leur culture d’appartenance pour revivifier une époque pauvre en sens, chiche en espoir. C’est ici que prend place, pour eux, pour moi, le rapport aux livres et à la tradition. Dans chaque culture, il y a ce que j’appellerais « un noyau de sens ». Ce noyau les intéresse. Pour s’en rapprocher, ils lisent… Est-ce de la nostalgie ? Moi, j’appelle ça la Vie.
Car Le Monastère buissonnier n’est pas un roman conventionnel. C’est un roman sous forme d’archipel, une succession de récits qui se déroulent tantôt au Japon, tantôt au Cameroun, au Bengale ou en Gaspésie. Certaines de ces histoires, les plus longues, sont de petits romans dans le roman.
Extrait de l’entretien
Vos personnages disséminés aux quatre coins du monde constituent une sorte de fraternité secrète. Pourtant, on trouve chez vous un rejet de tout ce qui pourrait ressembler à la culture d’Internet. En quoi ce que vous valorisez dans ce livre est-il irréconciliable avec le rapprochement des êtres et des cultures que permettent les nouvelles technologies ?
C’est peut-être surtout une question de profondeur et d’intensité. Je ne suis pas certain que les nouvelles technologies rapprochent vraiment les personnes. Sommes-nous moins seuls aujourd’hui qu’il y a, disons, cinquante ans ? J’en doute. Les nouvelles générations connaissent-elles mieux les œuvres littéraires, musicales et philosophiques de leur culture d’appartenance, sans parler des œuvres étrangères, des classiques de la littérature mondiale et de la profonde diversité des cultures dans lesquelles s’est illustré le génie humain ? Ce serait beaucoup attendre d’Internet… Les nouveaux moyens de communication sont pourtant extrêmement efficaces. Pour cette raison, ils ne disparaîtront pas. Mais ils ne sont pas structurants sur le plan de la pensée, du langage et de la culture. C’est l’inverse ! Voilà pourquoi je pense qu’il est primordial de développer une attitude de saine indépendance, de liberté par rapport à ces « distracteurs » qui colonisent notre esprit, notre imaginaire, nos rapports aux autres.
Cela dit, Le Monastère buissonnier ne se complaît pas dans une critique des nouvelles technologies. Il y a quelques allusions, sans plus. L’enjeu, pour moi, n’est pas de critiquer, mais de faire apparaître autre chose. J’imagine des vies et des compagnonnages qui sortent de l’ordinaire, à tous égards. Le défi est de faire exister, ici et maintenant, d’autres façons d’être ensemble, et de se situer sans attendre dans le cœur battant de la culture, plutôt que d’en déplorer la perte. Pourquoi critiquer le monde de l’image si l’on est incapable de faire aller sa propre imagination ? La-Mèche-Noire, on le sait, a beaucoup d’imagination. Il séduit, inspire et infléchit l’esprit des lecteurs en racontant des histoires… Pour ma part, je préfère l’intensité de la relation qui unit Audrey et Antoine à un compte Facebook suivi par dix mille « amis » ! En adoptant et en éduquant pendant cinq ans, sans interruption, deux gamins des castes défavorisées, Ramlochan fait plus pour eux que ne le pourra jamais toute « la culture d’Internet » ; il leur redonne la vie, l’espoir, et même le désir de transmettre le don reçu.
Livre publié dans la collection « Liberté grande ».