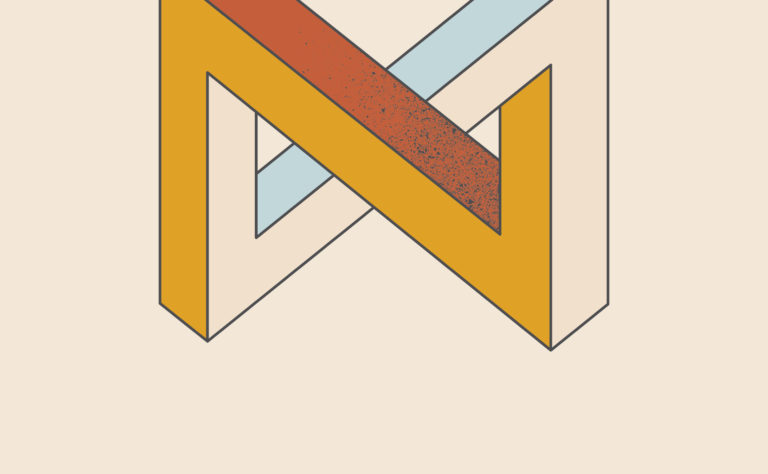Notre entretien
avec Jean-Simon DesRochers
Dans votre roman, la planète est terrorisée par une société secrète que dirigent de richissimes femmes d’affaires. Est-ce le reflet de votre vision de la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui ? Ou un fantasme ?
Il m’est impossible de penser à la place des femmes, ce serait la fois essentialiste et réducteur. Les femmes n’ont pas à avoir une place. Chaque personne, peu importe son genre, est un fragment du même monde.
Dans ce roman, le lien à cette société secrète n’est jamais plus que les récits intérieurs de deux femmes qui participent à une rébellion terroriste aux objectifs non officiellement déclarés. Ce regroupement représente une infime minorité de personnes, non pas les femmes. Son financement, quant à lui, sous-entend que cette rébellion serait rendue possible par une poignée de femmes ayant su jouer à fond la carte du libéralisme afin, ultimement, de chercher à en fragiliser les bases ou à l’inverse, de les consolider par l’exercice de la terreur. Mais encore, ce roman ne s’intéresse pas frontalement à la grande histoire et il ne révèle jamais ouvertement les objectifs de ce regroupement. Bien sûr, ce flou est volontaire : la personne lectrice y associera ce qu’elle veut bien si elle ressent le besoin de juger ces personnages.
Le roman a été conçu avec en arrière-plan des mouvements comme Extinction Rebellion (heureusement pacifique) ainsi que l’emblématique #metoo qui marque la quatrième vague féministe. Comme le sort de l’écoumène est intrinsèquement lié à notre capacité à cohabiter respectueusement en prenant la pleine mesure de notre multiplicité (et chez moi, ce nous dépasse la sphère humaine), il est clair que ces considérations ont orienté mon imaginaire. Mais comme dans la majorité de mes romans, je ne juge aucun des personnages, pas plus que je ne condamne ou cautionne leurs actions. Je les présente à partir de fragments de leur intériorité propre – et de l’intérieur, rares sont les personnes qui agissent en ayant l’assurance d’avoir tort.
Votre roman se présente comme une suite de microrécits reliés de façon presque arbitraire, ou pour le moins imprévisible. Comment arrive-t-on à inventer autant de personnages si différents, tout en restant si riches et si nuancés ?
De ma perspective, il s’agit surtout de nouvelles denses et fluides qui tissent un roman de la multiplicité. Ce qui les relie relève essentiellement des rapports au déni qu’entretiennent les personnages. Quant à la question du pourquoi un tel nombre de personnages principaux, je me la suis longtemps posée. Une partie importante de la réponse est venue avec un récent diagnostic d’autisme. Dans mon cas, entre bien d’autres choses, cela signifie que je n’ai jamais compris comment les humains agissent entre eux, ni même ce qu’est être femme ou être homme. En clair, tout m’est étranger et j’ai le sentiment d’exister en marge du monde. Afin de me permettre d’exister socialement, très jeune, j’ai appris à observer les autres, à les détailler dans leur manière d’être et d’agir, parfois pour les copier, plus souvent pour éviter de calquer leurs comportements. Contrairement aux discours officiels qui tardent toujours sur les récentes avancées de la recherche, certains autistes sont très aptes à l’empathie. C’est précisément mon cas : si mon attention se porte sur une personne, je la ressentirai de l’intérieur avec une intensité potentiellement insoutenable. Afin de ne pas constamment subir les contrecoups de cette hyperempathie, j’en ai fait un outil – non par choix, mais par réflexe de survie.
Avec un tel outil, lorsque je conçois un personnage, je pars d’abord d’un corps figuré, une présence physique extérieure très détaillée que je vis ensuite de l’intérieur comme s’il s’agissait d’une personne réelle, placée devant moi. Je tente alors d’anticiper ses paroles, ses actions, sa manière de se contredire, de mentir, de se convaincre et ainsi de suite. Ce même exercice d’anticipation, je le fais chaque fois que je dois converser avec une personne aux intentions non déclarées ou dissimulées (oui, c’est épuisant). Parallèlement à ce mode de fonctionnement autiste, j’ai développé à l’adolescence un très vif intérêt envers l’écriture. Et depuis, ces deux aspects de ma personne évoluent ensemble. C’est l’une des raisons pourquoi, chez moi, écrire est un besoin vital.
Chaque personne, peu importe son genre, est un fragment du même monde.
Extrait de l’entretien
Vous nous faites faire trois fois le tour de monde, mais nous revenons toujours à Clio. Pourquoi avoir placé cette adolescente, aux préoccupations semblables à celles de la plupart des filles de son âge, au cœur de votre roman ?
Hormis la phase actuelle, où j’ai le privilège d’être en pleine maîtrise de mes moyens, la période de ma vie où je me suis senti le plus en phase avec moi-même fut la période de mes huit à douze ans, soit avant que je me frotte à un monde pour lequel je n’étais pas préparé. J’évoluais alors dans des contextes sûrs, prévisibles, dotés de règles claires : du bonbon pour l’autiste que j’étais. Alors que j’avais la vingtaine pénible, je me suis posé la question du moment où mon intelligence et mes aptitudes avaient atteint leur sommet et, très vite, j’ai constaté que c’était à ce moment, quelque part entre huit et douze ans. C’est donc une période que j’aime bien.
Clio a plusieurs fois changé d’âge au fil de l’écriture du roman. Parfois huit, dix ou douze ans. Mes choix narratifs ont fait en sorte qu’elle avait besoin d’une certaine autonomie et d’une agentivité plus vive. Ce fut donc douze ans. Étant le parent d’une brillante jeune femme de seize ans, je ne saurais dire si j’ai su capter les préoccupations des gens de l’âge de Clio, mais j’ai assurément eu un accès privilégié à une autre manière de percevoir le monde en ce début de XXIe siècle.
Si j’ai placé Clio au centre gravitationnel du roman, c’est peut-être parce que j’estime que le monde doit davantage tourner autour des personnes qui en hériteront, non pour en faire des rois et des reines, mais des sujets à part entière. Qui souhaiterait léguer à ses enfants un champ de ruines? Cela n’est toutefois pas un hommage à la « pureté de l’enfance » – non, personne n’est pur et tant mieux, autrement, la vie serait insupportable et la littérature, impossible. C’est surtout une question de care : si nous prenons grand soin des personnes qui nous suivent, nous devons nous préoccuper autant de l’unique monde dans lequel elles existent. Avec ces idées à l’esprit, il me semblait logique qu’un roman articulé sur de multiples formes de déni se replie sur une enfant de douze ans.