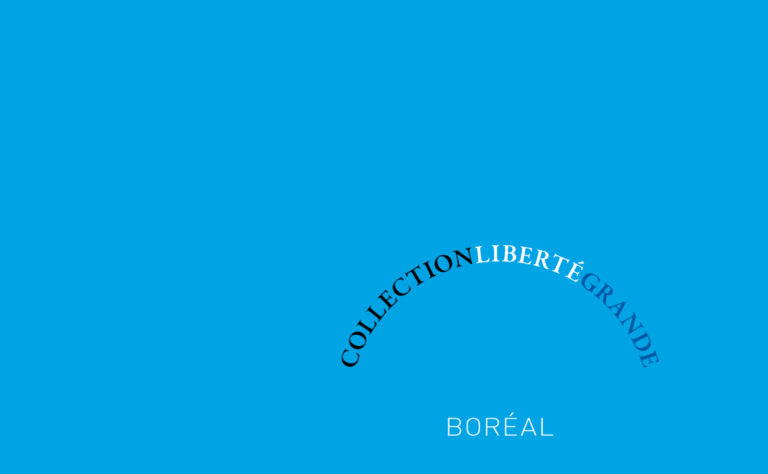Extrait
Élevée entre une gouvernante et des parents autoritaires et distants, la narratrice de La Voie romaine raconte une enfance du XIXe siècle, éclose dans la France rurale des années 1980. Égarée en elle-même, condamnée au mutisme avant que l’écriture vienne en elle ouvrir la voie de la parole, elle évoque une forme de pensée très singulière, celle qui précède le langage.
Souvenir d’un temps qui dura trois ou quatre ans, quatre ou cinq ans, où je ne parlais pas : ce que je nomme la voie romaine. Ce temps est à présent pour moi comme un chemin profond, premier, enseveli – fondateur de tout le reste, et dont on peut par ailleurs parfaitement ignorer l’existence. Le regard des adultes sur le cas que je constituais : les parents de mon père m’avaient déjà désavouée, et vouée à l’avenir d’une épluchure de céleri-rave. Ils reportaient leur attention sur mes cousins, ces normaux énormes et bientôt normaliens, bonne race de bétail qui allait faire médecine ou bien polytechnique; et je n’étais au milieu d’eux qu’un fruit pourri.
Le cours de cette pensée – car je pensais, quoique sans le support des mots : réflexion d’un autre ordre, très différent de l’ordre courant des hommes, dont la forme d’abstraction est fondée sur la forme de leur langue. Qu’était-ce, à cette époque, qu’était-ce pour moi que de penser ? Je ne le sais plus exactement : comme un verre qui, cassé, n’est plus jamais entier mais pour toujours cassé, l’action du verbe sur l’esprit n’est pas rétrogradable. Mais je garde en moi l’empreinte, la forme de cette pensée, faite surtout de sons et d’odeurs : c’est la voie romaine.
Il y avait alors des pensées violentes, aiguës, au suc empoisonné, prenant la forme d’odeurs rouges et âcres, celles des fleurs malsaines et mortuaires que sont les glaïeuls. Il y avait des pensées rondes, vertes et végétales, où toute chose était à sa place, et qui avaient l’odeur des feuilles de tomates. Et il y avait aussi les sons pour me guider à travers les dangers des hommes; bruits précieux, signifiants, rares dans un monde taiseux.
Un moteur de voiture, le gravier qui crisse dans la cour et le sang qui bourdonne soudain aux oreilles; tiens bon, mon cœur, frappe ton pas sans crainte; ils sauront point rien.
Je voudrais raconter le bruit du mensonge.
Je voudrais raconter le bruit du mensonge.
Extrait du livre
C’est un soir, je dois avoir quatre ans. Je suis au salon, dans la maison chaude, dans la maison claire, dans la maison de Tatie. On regarde un film, sur le poste de télévision en noir et blanc; c’est quelque chose comme Le Cercle rouge, je me souviens d’une grande tension qui avait monté en moi comme un ressort compressé. Je vois Montand, sortant sa carabine, en astiquer le canon, fondre ses plombs; l’escalier gravi à pas de velours; la grosse américaine que conduit Delon et qu’il arrête dans un champ; la cigarette allumée sans hâte; le coffre qui s’ouvre; tu peux sortir maintenant. Ces images avancent, et mues par la nécessité de leur enchaînement elles tracent en moi comme en un disque de cire des sillons qui ne s’effaceront jamais. Tout à coup, le ressort lâche et, moi-même lâchée par sa détente, me voici sans explication courant à la chambre où je dors, au baldaquin tendu de chambray bleu et blanc. Un instant plus tard, enfoncée dans le lit, je réalise ce qui s’est passé : derrière l’action du film, tout mon être était aux aguets d’un autre danger que celui du veilleur de nuit de la place Vendôme : avant tout le monde, y compris moi-même, mes sens ont entendu venir la voiture de mon père, rentré ce soir plus tôt que d’habitude. Il va venir ici, il va me reprendre; je vais devoir quitter la maison chaude pour toute une nuit. Je ne m’en sens pas capable. Maintenant, me voici bêtement dans ce lit, en proie à la terreur la plus absolue; mon cœur d’enfant sort de ma poitrine, et il me semble le voir battre, agonisant, là, devant moi, sur le plancher; Tatie va recevoir mon père d’un instant à l’autre, elle va lui dire sans doute, Je ne comprends pas, elle vient de filer au lit en courant sans même nous dire bonne nuit, attendez, je vais la chercher, elle ne doit pas encore dormir, ce n’est pas possible, une enfant pareille, je vous en prie, entrez un moment, monsieur Bourion, je vois qu’il pleut, le temps est bizarre ces jours-ci, c’est peut-être cela, aussi, qui énerve l’enfant.
Je garde en moi l’empreinte, la forme de cette pensée, faite surtout de sons et d’odeurs : c’est la voie romaine.
Extrait du livre
C’est l’automne alors, l’automne avancé, il fait nuit noire depuis longtemps, et ce soir, nous avons fait griller des châtaignes sur le poêle. L’odeur est encore là, dans toute la maison, pensée sombre et puissante qui évoque l’histoire et rappelle l’âge des comtes du Forez. On sonne.
Tatie se lève du fauteuil. Elle ouvre. Je reconnais la voix de mon père. Combien vais-je être questionnée, accusée de cette affaire que Tatie n’aura pas comprise, mais dont lui, qui sait, aura tôt fait de démasquer les raisons. Je reconnais la voix de mon père, mais je ne perçois pas ses paroles qui se perdent au-dehors dans la nuit de l’hiver commençant.
Un temps passe. Contre la vitre de la chambre dont les volets ne sont pas clos, j’entends grésiller un insecte qui demande l’asile pour la nuit ; je ne peux pas bouger pour lui ouvrir, et sa souffrance me fait de la peine. Lui dehors, moi dedans, nos deux chagrins ne peuvent se rejoindre.
Alors, Tatie : Mais il y a longtemps qu’elle est couchée, ce soir elle avait un peu de fièvre, donc je l’ai mise au lit très tôt. Vous la verrez demain.
Que se passe-t-il, après? La porte se referme. J’attends, pour être plus sûre, encore un long moment avant de sortir de mon refuge. Et puis, lorsque j’estime que le danger est loin, je me relève, à pas de loup, se méfier des fenêtres qui montrent et trahissent, nul n’est à l’abri d’un mirador; je vais jusqu’à la cuisine, où j’ai vu de la lumière; Tatie est là, assise à la table sous la lampe, qui regarde le journal, antique expression de mon peuple d’illettrés; oh bon peuple qui ne discourt pas, peuple qui comprend sans mots, qui parle juste et sans littérature. Alors Tatie lève les yeux sur moi avec une infinie bonté, avec une infinie tristesse aussi, car elle sait des choses que je ne sais pas encore, alors Tatie me regarde lentement, et elle me dit avec la grandeur noble et simple qui fait sa force, elle qui est faible, et sa beauté, elle qui n’est pas belle, alors Tatie me dit, Allez, va te brosser les dents, ils sauront point rien.
Un moteur de voiture, le gravier qui crisse dans la cour et le sang qui bourdonne soudain aux oreilles; tiens bon, mon cœur, frappe ton pas sans crainte; ils sauront point rien.
Livre publié dans la collection « Liberté grande ».