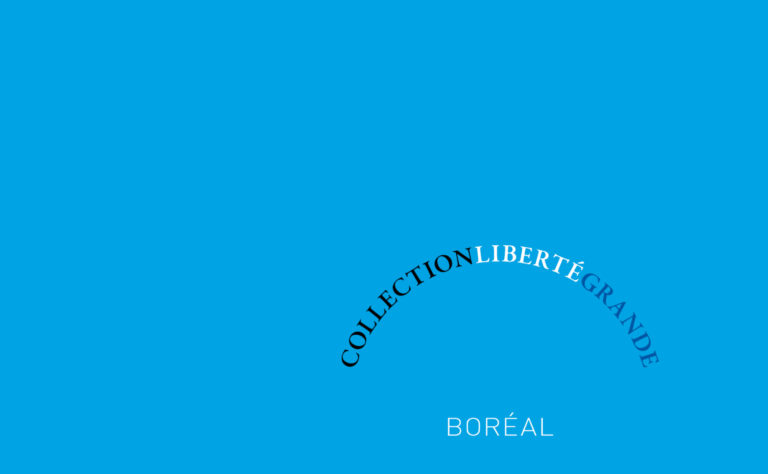Notre entretien
avec l’autrice
Vous vous intéressez aux journaux de deuil laissés par des écrivains reconnus pour leurs romans ou leurs essais. En quoi ce face-à-face avec la mort d’un proche les amène-t-il à changer leur manière, pour peu que ce soit le cas?
Ce n’est pas le cas de tous les écrivains. Joan Didion, l’autrice du très célébré L’Année de la pensée magique, se sert de la lucidité qui lui est coutumière pour décortiquer d’une façon très clinique les émois et affects de son deuil. C’est ce qui en fait d’ailleurs un texte exemplaire. En ce sens, elle ne rompt pas avec le ton qui est le sien, même si elle pénètre sans équivoque dans le territoire autobiographique. Dans d’autres cas, des écrivains réputés pour leur œuvre de fiction s’engagent tout à coup et pour la première fois sur le terrain autobiographique, pour livrer un récit très brut de leur expérience vécue. C’est le cas de l’auteur britannique Julian Barnes, avec Quand tout est déjà arrivé, dans lequel il s’autorise, mais seulement dans la dernière partie du texte et après plusieurs détours, à aborder de front le deuil de son épouse; ou encore de l’autrice danoise Naja Marie Aidt, poète et nouvelliste, avec Si la mort t’a pris quelque chose rends-le. Dans d’autres cas, on voit l’infléchissement durable de l’œuvre par l’expérience du deuil : par exemple chez la poète canadienne Helen Humphreys qui, dans son tout récent And a Dog Called Fig, revient près de dix ans plus tard sur la perte de son frère qu’elle avait racontée dans le très beau Nocturne. Et c’est bien sûr le cas de Blue Nights de Joan Didion, un second journal de deuil, consacré cette fois à la disparition de sa fille, et après lequel elle dit qu’elle n’écrira plus.
Vous étudiez des œuvres d’époques et de pays différents, écrites par des femmes ou des hommes. Y a-t-il une constante dans le travail du deuil au sein de ces textes?
Il y a un grand nombre de constantes, et c’est ce qui m’a amenée à vouloir les faire dialoguer ensemble dans un essai. Toutes les œuvres expriment la surprise du deuil, qui prend en défaut de toute préparation. Toutes mettent l’accent sur le quotidien rompu par la perte du proche, et la difficulté de revenir au lieu de vie partagé. Toutes insistent sur la continuation, par-delà la mort, de la relation avec l’autre disparu, ce que j’ai appelé la conversation silencieuse, qui est aussi la manifestation d’un dernier âge de l’amour : la relation ne meurt pas avec la mort de l’être aimé, mais ouvre à un ultime épisode. Toutes critiquent ce que l’on a coutume d’appeler le « travail de deuil », en particulier pour son caractère normé, qui prescrirait un rythme unique, alors que chaque deuil se vit comme singulier. Dans tous les textes, le deuil apparaît comme un événement majeur qui bouleverse l’idée même qu’on se faisait de sa propre vie, et introduit ce que je présente comme une dernière vie, l’écrivain face à sa propre disparition. Enfin, chaque texte a son idiosyncrasie, ce qui pourrait être considéré comme une autre forme, paradoxale, de constante : le trait commun de ces textes est de n’être pas communs, d’être atypiques, des textes étonnamment inventifs et originaux, qui ne renoncent pas du tout aux pouvoirs du littéraire face à la douleur et à la catastrophe, mais au contraire s’en saisissent pour dire au mieux cette part incontournable de l’expérience humaine.
Je propose que l’écriture est une méthode de deuil.
Extrait de l’entretien
La disparition des rituels dans nos sociétés est particulièrement évidente dans le cas du deuil. Est-ce l’une des fonctions – ou des pouvoirs – de la littérature que de remplacer ces rituels?
Pour mieux vous répondre, je ferais ici une distinction entre écriture et littérature, telle que la faisait d’ailleurs Roland Barthes, dont le Journal de deuil est la première inspiration de cet essai et le modèle de nombre des journaux de deuil que j’évoque.
Sur le plan individuel, c’est le rituel quotidien de l’écriture qui aide l’écrivain à faire son chemin dans son deuil, par notations brèves et fragments, à l’échelle de l’heure ou du moment. D’où la forme-journal qui prévaut. De ce point de vue, je propose que l’écriture est une méthode de deuil, comme lorsque l’écrivain et poète Dominique Fourcade parle des « petites formes plusieurs par jour » qui l’aident à surmonter le déchirement de la perte subite de son ami et éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, dans son texte intitulé simplement deuil en minuscules.
Autre chose se passe avec la littérature qui est alors constituée par ce nouveau corpus et ce nouveau genre littéraire : on entre dans un patrimoine de formes communes, et c’est par ce rapprochement entre les textes qu’il prend toute sa force, sa visibilité sociale, et qu’il devient réellement disponible pour toutes et tous – c’est pourquoi il me semblait si important de le mettre au jour. Ce que nous avons perdu avec les rituels, c’est ce sentiment de la communauté. Or l’expérience du deuil requiert une telle communauté : il nous faut savoir que d’autres ont fait ce chemin avant nous, et qu’ils ont survécu. Et qu’ils aiment encore leurs morts, tout en ayant trouvé d’autres moyens de vivre avec eux. Et l’écriture, la lecture, la littérature en font partie.
Livre publié dans la collection « Liberté grande ».
Postface de Catherine Mavrikakis.