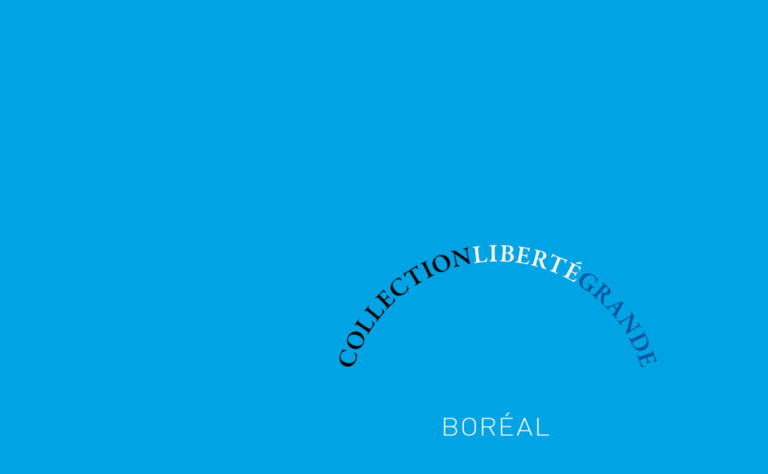Extrait
David Bélanger et Michel Biron ont profité du confinement pour réfléchir librement sur un aspect singulier de la littérature, sinon de notre époque : l’ironie.
11 mai 2020
Cher David,
Je savais que tu serais un excellent interlocuteur et que tu poserais de vraies questions, celles auxquelles il est difficile de répondre. Je savais aussi que tu parlerais depuis une perspective différente de la mienne, m’obligeant à préciser ma pensée, à la nuancer sans tomber dans le vaseux, dans le consensuel. J’appartiens à cette génération intermédiaire qu’on dit X, celle qui suit les baby-boomers, celle qui a vécu dans l’ombre de ceux-ci et qui a été habituée à laisser l’avant-scène à ses prédécesseurs, à ses « maîtres ». Je nous trouve souvent très « pâles » à côté de nos aînés, mais aussi de ta propre génération, qui me semble avoir davantage de couleur et de personnalité. Je sais bien que le concept de génération est un abominable fourre-tout, mais les clichés ne sont pas tous forcément des mensonges…
[…]
Avant de poursuivre cet exercice périlleux de « mais » adossés les uns aux autres, je me donne donc une petite chance et te renvoie la balle, ne serait-ce que pour vérifier si tu es d’accord avec le début de la phrase ci-dessus (« Le monde de Tess ou de Molie prolonge celui de Mille Milles ou de Bérénice ») et surtout avec le verbe prolonge. Il me semble que ce verbe rend bien compte du fait qu’il n’y a pas rupture, que les choses continuent, quoiqu’avec d’autres moyens…
J’ajoute ceci pour ne pas terminer en ayant l’air de me défiler derrière autant de « mais »: s’il y a prolongement et non rupture, n’est-ce pas parce qu’il n’est tout simplement plus nécessaire de rompre? Je veux dire par là que ça rompt tout seul, que la différence entre le monde d’aujourd’hui et celui de Ducharme est si immense, si évidente, que le romancier n’a pas besoin d’en rajouter. Le savoir littéraire est nul et non avenu: phrase impensable en 1965! Pour moi, c’est un abîme qui s’ouvre, ça me donne le vertige; pour toi, c’est un constat presque serein, une libération, une ouverture! Voilà tout à coup que ce savoir ancien, élément chimique désormais inactif, devient « agréable et disponible ». L’absence du maître n’a jamais été plus légère!
Bon, je m’arrête en espérant ne pas avoir écrit trop de bêtises. Au plaisir de voir comment tu réagiras à ces propos décousus.
Amitiés,
Michel
[…]
17 mai 2020
Cher Michel,
Depuis que j’ai reçu ta lettre, je ne cesse de penser aux questions qui la traversent: je marche dans toute la ville, qui voit enfin ses tulipes éclore, je cours vers l’est dans la rue de Rouen jusqu’au marché Maisonneuve, le confinement devient plus léger de foulée en foulée et les idées me viennent […].
J’annonçais un double exemple, voici l’autre: lorsque j’étais étudiant au cégep, on m’avait choisi pour représenter mon établissement au sein du jury du Prix littéraire des collégiens. En marge du Salon du livre de Québec, nous étions plus de soixante étudiant.e.s réuni.e.s dans un grand hôtel de la Vieille Capitale à nous crêper le chignon pour choisir l’heureuse œuvre élue. Il fallait nous voir: on se prenait au sérieux, on allait là défendre « la littérature » et nous savions confusément que nous devions dans cet exercice faire gagner une œuvre qui représentait l’idée qu’on se faisait de la chose; peut-être défendions-nous davantage cette « idée », en fait, que la meilleure proposition. Cette année-là, Catastrophes de Pierre Samson, roman archilittéraire, cabotin, ironique, qui riait de la critique Danielle Laurin, qui se moquait de Marguerite Duras et qui vomissait sur l’institution littéraire vieillotte, sur ses réseaux et sur ses subventions, était opposé à Ce n’est pas une façon de dire adieu de Stéfani Meunier, roman d’amour qui se passe à New York, cœurs brisés, idéaux déçus, mais quand on tient à son rêve, rien ne peut nous arrêter, etc. (Je ne dis rien du troisième livre en lice, Espèces en voie de disparition de Robert Lalonde, de loin supérieur aux deux autres mais affligé d’un double défaut: recueil de nouvelles, il ne faisait pas le poids devant les romans, et surtout, le débat étant polarisé entre deux visions du monde, il avait du mal ne serait-ce qu’à intégrer les discussions.) Je le répète, nous étions sérieux. Et on ne va pas s’étonner que, parmi les cégépiens choisis par leurs établissements pour les représenter, un nombre considérable d’étudiant.e.s en « arts et lettres » étaient sur place, défendant de surcroît leur « domaine », souvent contre des étudiant.e.s d’autres disciplines qui aimaient être touché.e.s par de belles histoires et, surtout, qui détestaient la complexité cérébrale et narquoise de Pierre Samson. La discussion en plénière a pris la forme de quolibets violents, les uns tançant les autres: « roman prétentieux pour public cultivé! », « roman naïf! », « roman moqueur et méchant! », « roman gentil et au premier degré! » Pastichant le titre du roman de Meunier, un étudiant d’un collège de Montréal a mis fin aux tours de parole avec cette réplique: « Ce n’est pas une façon d’écrire un bon roman. » Ce que je veux montrer avec cette anecdote se résume à ceci: dans ce combat sérieux pour la littérature, il fallait choisir l’œuvre ironique, le second degré, il fallait en tout cas rejeter avec véhémence la faiblesse du premier degré, sinon la littérature perdait. La littérature devenait ainsi, dans les débats, cette capacité de feindre, de retenir l’émotion primaire, non pas d’adhérer à un récit mais d’entrer en connivence avec un projet. Le roman d’amour, lui, apparaissait obscène. J’aimerais ici relever comment cette « obscénité » – que nous, collégiens qui-nous-voulions-lettrés, pourfendions – prend le contrepied de celle énoncée par Belleau quand il parle de « culture obscène ». Le contraste frappe: la culture ou l’idée qu’on s’en fait doit être défendue par nous, qui devenons alors les disciples de l’institution littéraire à laquelle nous sommes formés. Or, cette culture que nous défendons, pour qu’elle soit également acceptable, ne doit pas non plus se prendre trop au sérieux; la culture à défendre prend alors la forme d’un texte qui croit en lui-même sans y croire tout à fait, qui avance à reculons, qui résiste aux sirènes du Grand Art et aux sirènes de la naïveté, donnant naissance à une œuvre d’équilibrisme pour le moins étonnante. […]
Amitiés,
David
Livre publié dans la collection « Liberté grande ».