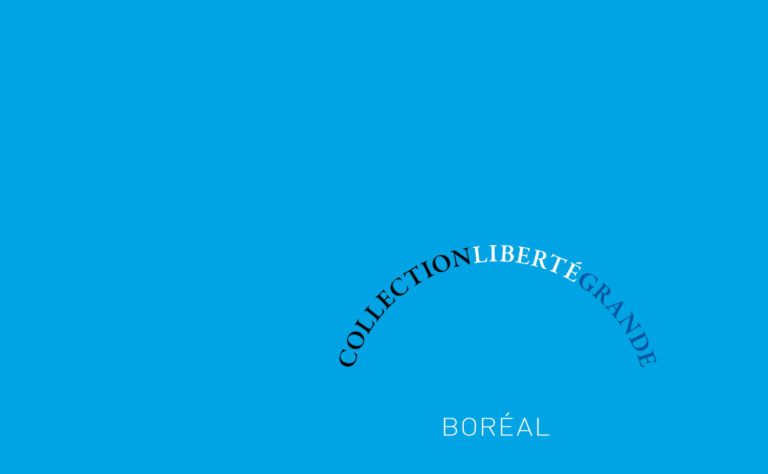Notre entretien
avec Jean-Marc Limoges
L’enseignement est-il selon vous, comme on l’entend souvent dire, une vocation?
À un collègue qui m’avait entendu parler avec un groupe d’élèves après un cours et qui m’avait ensuite lancé, un tantinet interloqué : « Toi, t’es un passionné », j’avais spontanément répondu : « Mais n’est-ce pas un prérequis? » Je pense que l’enseignement – comme n’importe quelle profession qui carbure à la passion – est une vocation. On n’apprend pas à être passionné ni à transmettre une passion. Je répète souvent qu’un professeur ne doit plus faire de distinction entre ce qu’il fait dans sa vie privée et ce qu’il fait dans sa vie professionnelle. Quand, pendant ce qu’on appelle « les vacances », je lis un livre, je n’arrive jamais à savoir si je le lis « pour moi » ou « pour mes cours ». Quand je lis un livre dans mon salon, j’ai immédiatement envie d’en parler dans ma classe et je brûle d’en analyser des passages avec mes groupes. J’ai la chance de me retrouver avec des élèves qui enrichissent la lecture des livres que je lis et qui me permettent de décupler mon plaisir. L’enseignement, c’est le plus beau métier du monde… ou la plus belle vocation.
Vous écrivez : « Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé apprendre, mais je n’ai jamais aimé l’école. » Manifestement, il y a quelque chose qui cloche. Alors que l’école devrait entretenir l’envie d’apprendre, elle fait plutôt office de « casseux de party ». Pour révolutionner une institution qui offre le contraire de ce que l’on attend d’elle, par quoi faudrait-il commencer?
On ne cesse de jeter la faute sur le « système ». Mais, à la base, le système est activé, actionné, mis en branle par des humains. Il existe un adage non écrit que les profs répètent ad nauseam entre les murs des institutions d’enseignement : « Devant ton groupe, c’est toi le boss. » Je l’ai souvent entendu dire; je l’ai rarement vu mis en pratique. Il ne tient qu’à chacun de nous d’incarner le prof que nous aurions aimé avoir! La réponse est simple : il faut que chacun commence par changer d’attitude. Il faut cesser de se présenter comme des fonctionnaires de la pensée chargés de passer à travers un programme ou comme les détenteurs d’un savoir que nous versons dans le crâne des cruches. Pour ma part, j’établis d’entrée de jeu ceci : « Je n’ai rien à vous apprendre. Par contre, vous avez tout à m’apprendre. » Ensuite, je prends un texte, au hasard, et on planche dessus ensemble. Je n’ai que très peu d’avance sur le groupe. Mon rôle est d’écouter, d’endiguer, d’orchestrer les réponses et d’inciter chacun à pousser plus loin sa réflexion. Dès lors, le cours devient « organique ». Nous nous retrouvons tous au même niveau et nous sommes tous étonnés en même temps. À partir du moment où le prof s’adresse à l’intelligence de ses élèves, à partir du moment où le prof attend beaucoup de ses troupes, chacun sent que sa parole a une valeur et que ses idées peuvent faire progresser la discussion. Personne n’aime se faire prendre de haut ou se faire prendre pour un épais, personne n’aime obéir ou être obligé à faire quoi que ce soit. Le plaisir est le moteur de nos vies. Pourquoi en irait-il autrement dans une salle de classe?
Aujourd’hui, les sources d’information (et de désinformation) pullulent de façon exponentielle, si bien qu’il semble vraiment important de savoir user d’un bon esprit critique pour départager le vrai du faux. Comment peut-on développer cette faculté chez les jeunes?
Justement…! Beaucoup semblent douter de la pertinence ou de l’utilité des cours de littérature au cégep (et de la fatidique Épreuve uniforme de français qui permet d’obtenir son Diplôme d’études collégiales). Or, il faut savoir que les outils conceptuels qu’on se forge pour analyser les œuvres afin de rationaliser nos impressions de lecture pourront toujours servir – même si on n’ouvre plus jamais un livre de sa vie – à débusquer la spécieuse idéologie ou la fourbe manipulation qui se terre dans n’importe quel discours : un message publicitaire, une harangue politique, une entrevue d’embauche, une nouvelle à sensation… Les connaissances littéraires formelles (procédés littéraires, classes de mots, figures de style, etc.) apprises entre les quatre murs d’une salle de classe nous permettent de mieux comprendre ce que nous disons et écrivons, ce que nous lisons et entendons dans la vie de tous les jours. Les cours de littérature nous permettent non seulement de décupler notre plaisir esthétique (en le rationalisant, puis en le partageant), mais aussi d’être moins dupes, de ne plus être à la merci de ceux qui veulent nous enfirouaper.
Le plaisir est le moteur de nos vies. Pourquoi en irait-il autrement dans une salle de classe?
Extrait de l’entretien
Vous réussissez à enseigner la grammaire et les grandes œuvres telles que celles de Montaigne et de Rabelais. Comment faites-vous pour intéresser vos étudiants et vos étudiantes?
Des collègues me reprochent quelquefois, par la bande, d’enseigner Rabelais ou Montaigne. On veut me faire croire que « c’est trop compliqué “pour eux” »… ou encore que « c’est trop loin de “leurs” intérêts ». Moi, ça me rend fou! Il se trahit, dans ces propos, une forme de mépris envers les élèves. D’abord, je pense que ce sont ces profs qui trouvent ces auteurs « trop compliqués pour eux » et qu’ils projettent leur propre incompréhension sur leurs élèves. Ensuite, il est impératif de se poser la question : « Si ce n’est pas nous, les profs, qui leur parlons de ces auteurs… QUI leur en parlera !? » Nous devrions donc nous sentir habités par une mission, voire mus par un sentiment d’urgence. Enfin, on peut bien se demander si ces auteurs sont si « loin » que ça de « leurs » intérêts…
Quant à moi, je répéterai jusqu’à ma mort que nous ne parlons ni la langue de Molière ni la langue de Voltaire, mais la langue de Rabelais. Je n’ai jamais compris pourquoi les Français eux-mêmes ne l’ont jamais fait valoir. Rabelais reste, curieusement, très peu lu. Pourtant, n’eût été son apport, notre langue française – si belle, si riche, si complexe – n’aurait jamais autant rayonné. On lui doit tout. Rabelais, c’est aussi notre premier humoriste. Sa saga gigantale est à se pisser dessus! Mais Rabelais, c’est en même temps un redoutable intellectuel. Pour moi, tout Rabelais se résume dans le « propos torcheculatif » que tient le jeune Gargantua à son père. On a là, d’un côté, le registre vulgaire, scatologique, comique, et, de l’autre, le registre savant, scientifique, sérieux, avec l’ajout d’un suffixe qui transforme le mot-valise en adjectif. C’est sublime! Rabelais, c’est la ripaille, la bombance, la bamboche, la débauche, la beuverie, la fête (du langage), mais aussi l’insolence, l’irrévérence, l’impertinence, l’anticonformisme, le refus d’aller dans le sens du commun. N’est-ce pas, au fond, beaucoup plus proche que nous l’imaginons des adolescents et des adolescentes qui remplissent nos salles de classe?
Pour ce qui est de Montaigne, rappelons qu’il a écrit l’une des œuvres les plus originales et les plus personnelles de toute la littérature. Après avoir perdu, très tôt, son meilleur ami – Étienne de La Boétie –, lequel lui avait légué sa bibliothèque, il s’enferme dans sa tour, entreprend de tout lire, de tout savoir, de tout connaître et d’« essayer » sa pensée sur tous les sujets : l’amour, la mort, l’amitié, la religion, l’éducation, la guerre, la gloire, etc. Honnêtement, je ne vois pas en quoi « c’est loin d’eux ». D’autant plus que son style est d’une beauté qui a rarement été égalée. Montaigne voulait, en écrivant, « poursuivre le dialogue » avec l’ami décédé. Quand on le lit, on sent qu’il parle, qu’il nous parle. Montaigne, c’est un compagnon qui nous murmure à l’oreille ses questionnements les plus intimes et qui nous enjoint à les prolonger dans notre vie quotidienne. Comment un adolescent de dix-sept ou dix-huit ans, par définition toujours un peu rebelle quant à toute forme d’autorité, peut-il ne pas se prendre d’affection pour un type qui lance : « Savoir par cœur n’est pas savoir »? Ou encore : « L’autorité de ceux qui enseignent nuit souvent à ceux qui veulent apprendre »? Dès que je cite ces aphorismes, je vois des yeux qui scintillent.
Les auteurs de la Renaissance sont tellement plus proches de ce que nous sommes, au Québec. En fait, nous sommes beaucoup plus près de l’esprit de la Renaissance que de celui du Grand Siècle ou de celui des Lumières. Il suffit d’ailleurs de lire La Défense et illustration de la langue française de Du Bellay pour sentir – dans la moelle de nos os – les échos que son cri entretient avec la situation linguistique qui est la nôtre. Le poète de la Pléiade enjoignait ses congénères à faire attention à cette langue jeune et frêle qui ne demandait qu’à survivre et à s’épanouir. Cinq cents ans plus tard, on en est toujours là! Et moi, je veux les convaincre qu’il est important, non seulement d’y faire attention et de la chérir, mais aussi de savoir s’en servir. Je veux leur montrer que la langue française n’est pas aussi absconse ni rébarbative qu’on a voulu nous le faire croire et que la maîtriser peut leur permettre d’afficher ou d’effacer leur subjectivité quand ils rétorquent à un ami qui vient leur apprendre qu’il subira sous peu un examen : « Je ne pense pas que tu pourras le réussir. » Ou : « Je ne pense pas que tu puisses le réussir. » Moi, je trouve ça fascinant que la grammaire nous offre le choix d’utiliser un indicatif ou un subjonctif. Leur enseigner la grammaire, c’est leur enseigner à avoir un ascendant sur leur langue, une maîtrise de leur être, un contrôle de leur monde.
Il m’envoya une violente claque au visage pour me guérir de mon insolence (oui, c’était l’époque où ceux qui exerçaient le contrôle pouvaient aisément le perdre). La marque est aujourd’hui disparue, mais mon insolence est restée.
Extrait du livre
Livre publié dans la collection « Liberté grande ».
Préface d’Alain Deneault.